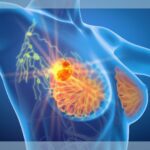Le Bloc québécois a remporté une victoire législative surprenante cette semaine lorsque son projet de loi sur la protection de la gestion de l’offre a été adopté par le Sénat après des mois de manœuvres politiques. Cette législation, qui vise à protéger les secteurs canadiens des produits laitiers, de la volaille et des œufs contre les concessions commerciales, a été adoptée malgré des divisions qui ont traversé les lignes partisanes.
J’ai passé les trois derniers jours à m’entretenir avec des législateurs, des experts en commerce et des agriculteurs sur ce que cela signifie pour l’avenir économique du Canada. La réalité, comme je l’ai découvert, est plus complexe que la victoire nette que revendique le Bloc.
« Il s’agit de protéger les familles canadiennes qui produisent notre nourriture », m’a confié le député bloquiste Gabriel Ste-Marie hier à l’extérieur de la Chambre des communes. « Nous avons promis à nos agriculteurs que leurs moyens de subsistance ne seraient pas des monnaies d’échange dans les négociations commerciales. »
Le projet de loi oblige effectivement les négociateurs commerciaux à obtenir l’approbation parlementaire avant d’offrir des concessions sur les secteurs sous gestion de l’offre dans les accords internationaux. Il a reçu le soutien d’une coalition de députés du Bloc, du NPD et de certains conservateurs, ainsi que d’indépendants clés au Sénat.
Mais l’ancien négociateur commercial canadien Steve Verheul a soulevé d’importantes préoccupations quant aux implications pratiques. « J’ai été assis face à des négociateurs américains et européens pendant des décennies. Cette législation nous lie les mains avant même que nous n’arrivions à la table », a-t-il expliqué lors d’un entretien téléphonique mardi. « Chaque négociation exige de la flexibilité. »
La gestion de l’offre est depuis longtemps une vache sacrée de la politique canadienne. Ce système, qui maintient des prix stables pour les produits laitiers, les œufs et la volaille grâce à des contrôles de production et des restrictions d’importation, soutient environ 16 000 fermes familiales à l’échelle nationale, dont près de la moitié sont situées au Québec.
Ce qui rend cette victoire législative remarquable, c’est la façon dont elle s’est produite. Le Bloc, qui ne détient que 32 sièges, a réussi à faire adopter l’un de ses projets de loi phares en forgeant des alliances inhabituelles. Des députés conservateurs ruraux ont rompu avec la direction du parti pour soutenir la mesure, répondant ainsi aux circonscriptions agricoles qui forment leur base.
Selon un récent sondage d’Abacus Data, 64 % des Canadiens soutiennent la protection de la gestion de l’offre, bien que ce soutien tombe à 51 % lorsqu’on leur demande s’ils accepteraient des prix alimentaires plus élevés pour maintenir le système.
La ministre du Commerce, Mary Ng, a exprimé des réserves quant à l’adoption du projet de loi. « Bien que nous soutenions fermement nos secteurs sous gestion de l’offre, nous devons maintenir notre capacité à négocier efficacement dans l’intérêt économique plus large du Canada », a-t-elle déclaré dans un communiqué fourni à Mediawall.news.
Les Producteurs laitiers du Canada ont célébré cette victoire. Leur président, Pierre Lampron, m’a invité à sa ferme familiale près de Trois-Rivières le mois dernier. En parcourant sa grange, il m’a montré les investissements qu’il a réalisés grâce à la stabilité que procure la gestion de l’offre. « Il ne s’agit pas seulement de protéger un système. Il s’agit de communautés rurales, de familles qui cultivent depuis des générations. »
Ce qui n’est pas largement compris, c’est comment le projet de loi pourrait affecter la position commerciale du Canada au-delà de l’agriculture. L’ancien diplomate Colin Robertson, qui a servi à Washington pendant les négociations de l’ALENA, a averti que la législation crée de nouvelles vulnérabilités.
« Nos partenaires commerciaux savent maintenant exactement où nous ne pouvons pas bouger », a expliqué Robertson autour d’un café près de la Colline du Parlement. « Dans des négociations complexes, révéler son jeu comme ça est problématique. Les Américains exigeront simplement des concessions ailleurs — peut-être dans des secteurs où nous sommes moins organisés politiquement. »
La législation a été adoptée par un vote de 42-38 au Sénat, reflétant des divisions profondes sur l’approche commerciale du Canada. Plusieurs sénateurs indépendants issus du milieu des affaires ont voté contre, citant des préoccupations économiques.
La sénatrice Pamela Wallin, qui représente la Saskatchewan, a déclaré à la chambre que bien qu’elle comprenne l’importance de protéger les agriculteurs, « nous ne pouvons pas nous isoler des réalités du commerce mondial ».
La politique de ce moment est particulièrement fascinante. Avec un gouvernement minoritaire qui tient à un fil et une possible élection à l’horizon, le Bloc a démontré une efficacité remarquable à faire avancer des priorités régionales ayant des implications nationales.
Au Restaurant Familial Adrien à Gatineau, où je me suis arrêté pour déjeuner après le vote, des agriculteurs et des travailleurs locaux débattaient des mérites du projet de loi. Roger Thibault, producteur laitier de troisième génération, a exprimé son soulagement. « Pour une fois, les politiciens nous ont écoutés au lieu de Bay Street », a-t-il dit en sirotant un café.
À la table voisine, Jamal Khouri, travailleur du secteur manufacturier, était moins convaincu. « Je soutiens les agriculteurs, mais mon emploi dépend des exportations. Si d’autres pays ripostent parce que nous protégeons les produits laitiers, qu’adviendra-t-il des pièces automobiles ou de l’aérospatiale? »
Cette tension reflète le dilemme commercial plus large du Canada. La gestion de l’offre soutient directement environ 1 % des agriculteurs canadiens, mais a une influence politique démesurée, particulièrement au Québec et dans l’Ontario rural où les élections sont souvent décidées.
Pendant ce temps, l’économie canadienne, dépendante des exportations, repose sur le maintien de relations commerciales positives avec des partenaires qui ont constamment ciblé notre système de gestion de l’offre, particulièrement les États-Unis.
L’économiste agricole Jennifer Parker de l’Université de Guelph souligne que les avantages et les coûts du système ne sont pas répartis uniformément. « La gestion de l’offre offre de la stabilité aux producteurs, mais les Canadiens paient parmi les prix les plus élevés pour les produits laitiers dans le monde développé », a-t-elle noté lorsque je l’ai appelée pour avoir son point de vue.
Alors que le projet de loi attend la sanction royale, la mise en œuvre pratique reste incertaine. Des responsables gouvernementaux s’exprimant sous couvert d’anonymat suggèrent que des approches diplomatiques créatives pourraient être développées pour maintenir la flexibilité de négociation malgré les contraintes de la législation.
Ce qui est certain, c’est que le Bloc a obtenu une victoire significative pour sa base tout en créant de nouveaux défis pour la stratégie commerciale canadienne. Que cela représente un triomphe démocratique ou un précédent préoccupant dépend entièrement de votre position — tant politique qu’économique.
Pour l’instant, comme l’a fait remarquer un membre du personnel du Sénat officieusement, « Le Bloc vient de réussir à dicter la politique commerciale internationale avec 32 sièges. C’est soit une politique impressionnante, soit un commentaire inquiétant sur notre système parlementaire. »
Alors qu’Ottawa se prépare pour la pause estivale, cette victoire législative pourrait bien remodeler l’approche du Canada en matière de négociations commerciales internationales pour les années à venir — avec des implications qui dépassent largement les étables laitières et les poulaillers qu’elle vise à protéger.