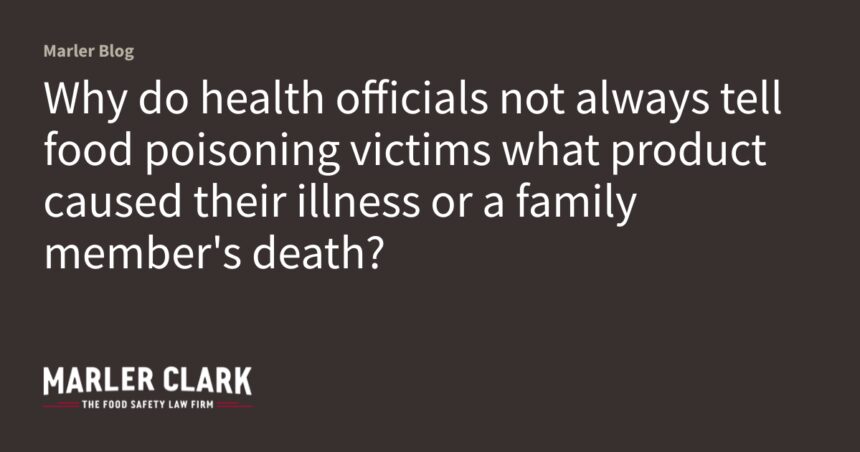Je me souviens encore du jour où Miriam Ortiz m’a invitée dans sa maison à Vancouver, les photos de famille ornant chaque surface de son petit salon. Elle m’a montré une photo particulièrement précieuse – sa mère Elena souriant depuis un lit d’hôpital, entourée de petits-enfants après ce que la famille croyait être une simple intoxication alimentaire.
« Trois jours plus tard, elle n’était plus là, » m’a dit Miriam, sa voix à peine audible. « Et personne ne voulait nous dire ce qui l’avait tuée. »
Elena, 78 ans, est décédée des complications d’une infection à E. coli en 2019. Malgré plusieurs demandes, la famille Ortiz n’a jamais su quel produit alimentaire avait causé sa maladie – une information qui aurait pu les aider à faire leur deuil et possiblement empêcher d’autres personnes de subir le même sort.
Ce silence n’est pas unique à la famille Ortiz. Partout au Canada, les victimes d’intoxications alimentaires et leurs familles se heurtent souvent à des murs bureaucratiques lorsqu’elles cherchent des réponses sur ce qui les a rendues malades.
« C’est comme se noyer dans le noir, » explique Taylor Wilson, qui a passé des semaines hospitalisé pour une listériose en 2021. « Je n’arrêtais pas de demander à mes médecins ce qui l’avait causée. Ils me disaient que l’enquête était en cours. Puis plus rien. Je ne sais toujours pas si c’était le fromage que j’ai acheté au marché local ou autre chose. »
Lorsque j’ai commencé à enquêter sur les raisons pour lesquelles les responsables de la santé publique dissimulent fréquemment des informations sur les produits contaminés aux personnes concernées, j’ai découvert un réseau complexe d’intérêts concurrents, de ressources limitées et de véritables dilemmes de santé publique.
La Dre Michelle Chan, épidémiologiste au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, m’a expliqué que confirmer la source des intoxications alimentaires individuelles pose d’importants défis.
« Pour les cas sporadiques – ceux qui ne sont pas clairement liés à une éclosion – établir un lien définitif entre la maladie d’une personne et un produit alimentaire spécifique nécessite des ressources d’enquête intensives que nous n’avons souvent pas, » m’a-t-elle confié lors d’une entrevue dans son bureau à Vancouver. « Sans preuves claires, nommer des produits pourrait avoir de graves conséquences économiques pour les entreprises tout en n’aidant pas nécessairement les patients. »
La base de données de l’Agence canadienne d’inspection des aliments montre qu’elle a émis 173 rappels d’aliments pour contamination microbienne en 2022, mais ceux-ci ne représentent qu’une fraction des cas de contamination suspectés. Selon les statistiques de Santé Canada, environ 4 millions de Canadiens souffrent d’intoxications alimentaires chaque année, mais seulement environ 3% des cas sont officiellement signalés et encore moins sont retracés à des sources spécifiques.
Lorsque j’ai visité les bureaux de la Régie de la santé du Nord à Prince George, le spécialiste de la sécurité alimentaire James Nguyen m’a expliqué le processus d’enquête, soulignant les limites des ressources.
« Nous faisons un suivi de chaque cas signalé, mais le traçage nécessite des entretiens intensifs, des tests de laboratoire et une enquête sur la chaîne d’approvisionnement, » a déclaré Nguyen, en montrant un tableau blanc couvert d’organigrammes. « Avec un personnel limité couvrant de vastes zones géographiques, nous priorisons les éclosions actives plutôt que les cas sporadiques, même si chaque individu mérite des réponses. »
Derrière ces contraintes de ressources se cache une tension plus profonde entre la divulgation publique et les intérêts économiques. L’Agence canadienne d’inspection des aliments maintient que son mandat principal est de protéger la santé publique, mais les producteurs et distributeurs alimentaires ont des préoccupations légitimes concernant les dommages à leur réputation causés par des attributions prématurées ou incorrectes.
Samantha Reynolds, avocate qui représente les victimes d’intoxications alimentaires depuis plus de dix ans au sein de la Coalition pour la justice des consommateurs, croit que la balance penche trop vers la protection de l’industrie.
« J’ai vu des familles dévastées non seulement par la maladie, mais par le mur de silence auquel elles se heurtent, » m’a confié Reynolds autour d’un café près de son bureau au centre-ville. « Lorsque les responsables retiennent des informations sur des produits contaminés qui ont été définitivement identifiés, ils choisissent la protection de l’industrie plutôt que la sécurité publique. »
La réalité, selon des documents internes que j’ai obtenus grâce à des demandes d’accès à l’information, montre que les autorités sanitaires confirment souvent les sources de contamination en interne tout en débattant si la divulgation publique sert l’intérêt général. Une note interne d’une autorité sanitaire régionale datée de 2020 indique : « Source confirmée comme étant le poulet de marque X, mais les mesures de rappel sont déjà complètes. Aucun avantage supplémentaire pour la santé publique à nommer le produit à ce stade. »
Ce calcul administratif laisse des victimes comme la famille Ortiz dans un douloureux limbe.
La Dre Aisha Malik, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général de Vancouver qui traite régulièrement des patients atteints d’intoxications alimentaires, constate le coût humain de ce manque d’information.
« Quand les patients me demandent ce qui les a rendus malades et que je ne peux pas leur dire, cela affecte leur guérison, » a-t-elle expliqué lors de notre conversation à la cafétéria de l’hôpital. « Il y a à la fois un besoin psychologique de clôture et des raisons pratiques de gestion de la santé pour que les patients comprennent exactement ce qui leur est arrivé. »
Certaines juridictions ont évolué vers une plus grande transparence. Le Département de la santé du Minnesota a mis au point une approche qui met l’accent sur la divulgation rapide des sources d’intoxications alimentaires, partageant l’information avec les personnes touchées même lorsque des annonces publiques plus larges ne sont pas justifiées.
Le Dr Michael Peterson, qui a aidé à développer le modèle du Minnesota, m’a dit lors d’un appel vidéo : « Nous avons constaté que la transparence renforce la confiance. Quand les gens comprennent ce qui les a rendus malades, ils sont plus susceptibles de signaler rapidement les maladies futures et de coopérer aux enquêtes. »
Plusieurs défenseurs canadiens de la santé poussent pour des réformes similaires. L’Association canadienne pour la sensibilisation à la sécurité alimentaire a proposé un cadre de « Droit du patient à l’information » qui établirait des protocoles clairs pour partager les informations sur les sources avec les personnes touchées, même lorsque des rappels publics ne sont pas émis.
Pour James Nguyen de Northern Health, le défi consiste à équilibrer de multiples responsabilités avec des ressources limitées. « Si nous avions du personnel et une capacité de laboratoire illimités, nous pourrions tracer chaque cas. Mais la réalité est que nous faisons quotidiennement des choix difficiles sur l’orientation de nos efforts. »
Ces défis systémiques offrent peu de réconfort aux familles comme les Ortiz. Trois ans après la mort d’Elena, Miriam vérifie encore compulsivement les avis de rappel d’aliments, se demandant si elle reconnaîtra quelque chose qui aurait pu se trouver dans la cuisine de sa mère.
« Ne pas savoir donne l’impression que nous l’avons laissée tomber, » m’a confié Miriam alors que nous regardions d’autres photos de famille. « Peut-être que si nous savions ce que c’était, nous pourrions avertir les autres. Sa mort pourrait sauver quelqu’un d’autre. »
Alors que le changement climatique et les systèmes alimentaires mondiaux créent de nouveaux risques d’intoxication alimentaire, la tension entre la divulgation et d’autres priorités ne fera que s’intensifier. La question demeure de savoir si nos systèmes de santé évolueront pour reconnaître que pour les victimes d’intoxication alimentaire et leurs familles, l’information n’est pas seulement une donnée – c’est une partie de la guérison.