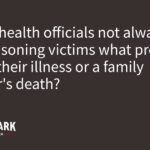Le silence s’est installé dans la salle lorsque la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a livré son évaluation des ambitions nucléaires de l’Iran la semaine dernière. Debout devant un panel d’experts en sécurité à Ottawa, ses paroles reflétaient une préoccupation internationale croissante.
« Le programme nucléaire iranien demeure une source d’instabilité grave au Moyen-Orient et au-delà, » a déclaré Anand, d’un ton mesuré mais indéniablement urgent. « Nous appelons à une désescalade immédiate et à un retour aux voies diplomatiques. »
Ces commentaires surviennent à un moment particulièrement volatil. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a rapporté en mars que l’Iran a accéléré l’enrichissement d’uranium à des niveaux quasi militaires—atteignant 60% de pureté alors que 90% est considéré comme de qualité militaire. Cette augmentation dramatique a raccourci ce que les experts appellent le « temps de percée »—la période nécessaire pour produire suffisamment de matière fissile pour une arme nucléaire—de plusieurs années à potentiellement quelques semaines.
« Nous assistons à un dangereux jeu de bord du gouffre, » explique Dr. Naomi Kikoler, directrice du Centre Simon-Skjodt pour la prévention du génocide, que j’ai interviewée après les remarques de la ministre. « L’Iran continue d’avancer son programme tout en maintenant juste assez d’ambiguïté sur la militarisation pour éviter de déclencher une intervention militaire directe. »
Cette avancée nucléaire se déroule dans un contexte d’instabilité régionale plus large. Le conflit israélo-palestinien en cours a davantage compliqué les efforts diplomatiques, l’Iran soutenant le Hamas et d’autres acteurs non étatiques à travers le Moyen-Orient. Les agences de renseignement occidentales ont signalé un soutien matériel accru provenant de Téhéran vers ces groupes depuis octobre 2023.
Pour le Canada, les enjeux sont autant personnels que géopolitiques. Le pays continue de chercher justice pour les 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents tués lorsque le vol PS752 d’Ukraine International Airlines a été abattu par des missiles sol-air iraniens en janvier 2020. Cette tragédie reste une plaie ouverte dans les relations canado-iraniennes.
« Les commentaires de la ministre Anand reflètent une frustration croissante parmi les alliés occidentaux, » affirme Trita Parsi, vice-président exécutif de l’Institut Quincy pour une politique étrangère responsable. « L’effondrement de l’accord nucléaire JCPOA en 2018 a supprimé des mécanismes de vérification essentiels, et les efforts ultérieurs pour relancer l’accord se sont enlisés. »
L’accord de 2015 (JCPOA) avait imposé des limites strictes au programme nucléaire iranien en échange d’un allègement des sanctions. Lorsque les États-Unis se sont retirés de l’accord sous la présidence Trump, l’Iran a progressivement abandonné ses engagements, intensifiant ses activités d’enrichissement et restreignant l’accès de l’AIEA aux installations clés.
En traversant l’édifice du Centre du Parlement canadien après le briefing, j’ai parlé avec une source diplomatique de haut rang qui a demandé l’anonymat pour s’exprimer franchement. « Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est le développement par l’Iran de centrifugeuses avancées et le savoir-faire accumulé, » a expliqué le diplomate. « Même si un nouvel accord était conclu demain, on ne peut pas effacer ces connaissances techniques. »
Les pressions économiques n’ont pas réussi à arrêter le programme. Malgré des sanctions paralysantes qui ont dévasté l’économie iranienne—l’inflation a dépassé 40% selon la Banque mondiale—le régime a privilégié l’avancement nucléaire au détriment du soulagement économique. Les exportations de pétrole vers la Chine fournissent une bouée de sauvetage financière qui soutient le programme malgré l’isolement international.
Le coût humain de cette impasse touche principalement les Iraniens ordinaires. Lors de mes reportages dans les pays voisins l’année dernière, j’ai rencontré des dizaines d’expatriés iraniens qui ont décrit comment les sanctions et l’isolement international ont décimé les moyens de subsistance de la classe moyenne tout en renforçant les éléments radicaux au sein du régime.
« Ma sœur ne peut pas obtenir ses médicaments contre le cancer à cause des restrictions bancaires, » a expliqué Maryam, une ancienne professeure d’université vivant maintenant en Turquie. « Pendant ce temps, les Gardiens de la Révolution contrôlent le marché noir et s’enrichissent grâce à la crise. »
L’appel de la ministre Anand à la désescalade intervient alors que les options militaires restent sur la table pour plusieurs acteurs. Israël a signalé à plusieurs reprises sa volonté de prendre des mesures unilatérales, tandis que les États-Unis maintiennent une présence navale importante dans le Golfe persique, y compris le groupe aéronaval USS Dwight D. Eisenhower.
« Nous approchons d’un point de décision, » prévient Michael Singh, directeur général de l’Institut Washington pour la politique au Proche-Orient. « Soit la diplomatie impose des contraintes significatives au programme iranien, soit nous faisons face à un risque croissant de confrontation militaire dans une région déjà volatile. »
Les évaluations techniques divergent sur les progrès réels de l’Iran vers la militarisation. Bien que l’enrichissement d’uranium se poursuive, la militarisation nécessite des étapes supplémentaires, notamment la conception d’ogives, la miniaturisation et l’intégration de systèmes de livraison. Les agences de renseignement divergent sur l’état d’avancement de ces travaux, bien que la plupart s’accordent à dire que les capacités se sont considérablement développées.
Pour le Canada, naviguer dans cette crise exige d’équilibrer plusieurs priorités : soutenir les alliés, prévenir la prolifération nucléaire, demander des comptes pour le vol PS752 et éviter une nouvelle escalade régionale qui pourrait menacer la sécurité mondiale.
« La déclaration de la ministre Anand trouve cet équilibre délicat, » note Roland Paris, professeur d’affaires internationales à l’Université d’Ottawa. « Elle signale une préoccupation sérieuse sans fermer les portes diplomatiques. »
Alors que la communauté internationale observe les prochains mouvements de l’Iran, les enjeux continuent d’augmenter. Ce qui a commencé comme une préoccupation régionale s’est transformé en un défi majeur pour la sécurité internationale en 2024, avec des implications bien au-delà du Moyen-Orient. La question demeure de savoir si la diplomatie peut encore prévaloir, ou si le monde fait face à une nouvelle crise nucléaire aux conséquences imprévisibles.