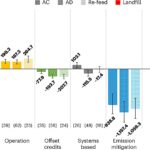Les couloirs du Centre de conventions Walter E. Washington à Washington bourdonnent d’une tension que même les diplomates les plus chevronnés ne peuvent dissimuler. J’ai passé les trois derniers jours à naviguer entre les périmètres de sécurité et les sessions à huis clos de ce que plusieurs analystes considèrent comme le sommet le plus déterminant de l’OTAN depuis la Guerre froide.
« Ce n’est pas simplement un autre cycle d’engagements, » me confie un haut attaché de défense européen qui a demandé l’anonymat pour s’exprimer librement. « L’Alliance fait face à des questions existentielles sur sa raison d’être et son financement que nous n’avons pas sérieusement abordées depuis des décennies. »
Au cœur de ce sommet se trouve un engagement ambitieux – les membres de l’OTAN se sont engagés à investir au moins 5% de leur PIB dans la défense d’ici 2030, une augmentation spectaculaire par rapport à l’objectif actuel de 2% que plusieurs nations peinent encore à atteindre. Cela représente ce que le Secrétaire général Jens Stoltenberg a qualifié de « bond quantique » dans la posture défensive de l’Alliance.
Cette décision intervient dans un contexte de détérioration des conditions de sécurité mondiale qui a fondamentalement modifié les calculs stratégiques occidentaux. L’agression continue de la Russie en Ukraine, l’expansion militaire de la Chine et les menaces émergentes dans le domaine cybernétique ont créé ce que le chancelier allemand Olaf Scholz a décrit comme « un moment charnière pour l’architecture de sécurité européenne. »
En parcourant le siège de l’OTAN à Bruxelles le mois dernier lors des réunions préparatoires, j’ai été témoin direct du changement d’ambiance institutionnelle. L’ambiguïté diplomatique qui caractérise habituellement les discussions de l’Alliance a disparu. À sa place, les planificateurs militaires parlaient avec une rare clarté des besoins en ressources et des scénarios de déploiement.
« Nous avons fonctionné avec les dividendes de la paix post-Guerre froide qui n’existent plus, » explique Dre Marta Dassù, ancienne vice-ministre des Affaires étrangères italienne et chercheuse principale au Conseil européen des relations étrangères. « L’objectif de 5% reflète une reconnaissance tardive que notre environnement de sécurité a fondamentalement changé. »
Les implications économiques de cet engagement sont colossales. Pour des pays comme l’Allemagne, atteindre les 5% signifierait presque doubler les dépenses actuelles de défense à environ 200 milliards d’euros par an. Les augmentations proposées représenteraient le plus important renforcement militaire en temps de paix en Occident depuis l’expansion de la défense sous l’administration Reagan dans les années 1980.
Pourtant, des questions importantes demeurent quant à la mise en œuvre. Lors d’un échange tendu que j’ai observé entre les représentants des États baltes et leurs homologues d’Europe du Sud, de profondes divisions sont apparues concernant les priorités de dépenses. Alors que la Pologne et l’Estonie préconisent des investissements dans les forces conventionnelles, l’Espagne et l’Italie mettent l’accent sur la sécurité maritime et la gestion des migrations.
« C’est là que le véritable défi commence, » note Ian Lesser, vice-président du Fonds Marshall allemand. « L’accord sur le pourcentage n’est que le point de départ. La conversation plus difficile concerne les capacités que ces investissements devraient prioriser et la rapidité avec laquelle elles peuvent être déployées. »
Les données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm montrent qu’atteindre le seuil de 5% augmenterait les dépenses de défense collectives de l’OTAN d’environ 500 milliards de dollars par an – ce qui équivaut à peu près à créer un autre budget de la taille du Pentagone au sein de la structure de l’Alliance.
Cet engagement arrive également dans un contexte politique complexe. Aux États-Unis, les faucons de la défense soutiennent le partage accru du fardeau tandis que les législateurs progressistes s’interrogent sur les coûts d’opportunité. À travers l’Europe, les gouvernements doivent justifier l’augmentation des dépenses militaires face à une inflation persistante et aux exigences de protection sociale.
En dehors du périmètre de sécurité du sommet hier, j’ai parlé avec des manifestants représentant une coalition d’organisations pacifistes. « Ils parlent de pourcentages pendant que les communautés luttent, » a déclaré Maria Gonzalez, une militante du mouvement espagnol Non à l’OTAN. « Cet argent pourrait s’attaquer au changement climatique ou aux soins de santé – des enjeux existentiels que les dépenses militaires ne résoudront pas. »
Les analystes militaires rétorquent que l’investissement vise à prévenir des conflits qui s’avéreraient bien plus coûteux. « La dissuasion n’est pas gratuite, mais elle coûte moins cher que la guerre, » soutient le général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant général de l’armée américaine en Europe. « Le seuil de 5% représente ce qui est réellement nécessaire pour créer des positions défensives crédibles le long du flanc est vulnérable de l’Alliance. »
Au-delà du chiffre principal, la déclaration du sommet comprend des engagements pour rationaliser les processus d’acquisition, intégrer les bases industrielles de défense et accélérer les filières d’innovation – des changements techniques qui pourraient s’avérer aussi importants que les objectifs de dépenses eux-mêmes.
Suite à l’allocution émouvante du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux dirigeants alliés, plusieurs membres de l’OTAN ont annoncé des transferts de capacités spécifiques qui commenceront à affluer vers les forces de Kyiv dans les semaines à venir. Ceux-ci incluent des systèmes de défense aérienne avancés, des plateformes de guerre électronique et des capacités d’artillerie que les commandants ukrainiens ont désespérément recherchées.
Plus significativement peut-être, le sommet a formalisé le virage stratégique de l’OTAN vers l’est. De nouvelles bases opérationnelles avancées, des stocks d’équipement prépositionnés et des structures de commandement régionales renforcées modifieront fondamentalement la posture défensive de l’Alliance le long de sa frontière de 1 600 kilomètres avec la Russie.
« Nous revenons à une doctrine d’endiguement, » explique Constanze Stelzenmüller, directrice du Centre sur les États-Unis et l’Europe à Brookings. « Mais cette fois avec des technologies, des menaces et des alliances qui rendent l’environnement de sécurité bien plus complexe que durant la Guerre froide originale. »
Alors que les délégués quittent Washington, le vrai travail commence dans les capitales nationales. Les ministres des Finances doivent identifier les sources de financement, les organes parlementaires doivent autoriser les dépenses, et les planificateurs militaires doivent traduire les augmentations budgétaires en capacités opérationnelles – tout en naviguant entre les contraintes politiques nationales et les priorités concurrentes.
Ce qui reste clair après ce sommet historique, c’est que l’OTAN s’est engagée dans une réorientation stratégique spectaculaire. Que cela représente une adaptation prudente aux menaces changeantes ou une dangereuse escalade des tensions internationales reste vivement débattu. Ce qui est certain, c’est que les décisions prises cette semaine redessineront l’architecture de sécurité occidentale pour les décennies à venir.