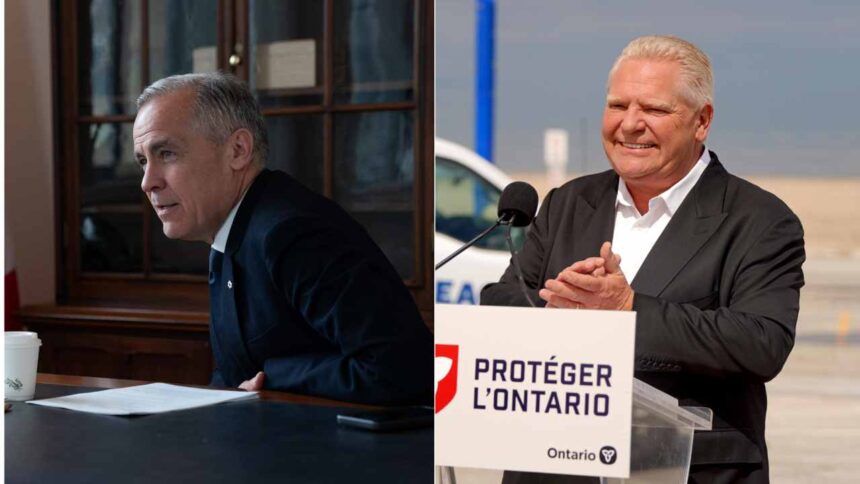Je me souviens encore d’être debout à un arrêt d’autobus de Toronto lors d’une vague de froid brutal en février, regardant trois autobus prévus qui ne se sont jamais matérialisés. Mes compagnons d’attente – des travailleurs de la santé se rendant à leurs quarts de nuit, des étudiants et des employés du secteur des services – devenaient de plus en plus frustrés alors que l’application de transport montrait les autobus disparaître de l’horaire en temps réel. Ce n’était pas un incident isolé, mais le symptôme d’une conversation plus profonde qui se déroule partout au Canada : que se passe-t-il lorsque les services publics font face à un sous-financement chronique, et la privatisation offre-t-elle une solution ou aggrave-t-elle le problème?
Le débat sur la privatisation s’est intensifié récemment alors que les gouvernements provinciaux à travers le Canada explorent la vente de parts dans tout, de la prestation des soins de santé aux transports en commun. Les arguments semblent simples sur papier : les entreprises privées apportent efficacité, capital d’investissement et innovation. Mais la réalité sur le terrain raconte souvent une histoire différente.
« La privatisation suit un modèle prévisible, » explique Dr. Heather Whiteside, économiste politique à l’Université de Waterloo et auteure de « Purchase for Profit: Public-Private Partnerships and Canada’s Public Health Care System. » « D’abord vient le sous-financement stratégique des services publics, puis la déclaration que le service échoue, suivie par la privatisation présentée comme la seule solution. Mais rarement voit-on les économies promises se matérialiser pour les citoyens ordinaires. »
Les chiffres soutiennent cette évaluation. Lorsque l’Ontario a privatisé l’autoroute 407, les tarifs initiaux d’environ 10 cents par kilomètre ont explosé jusqu’à près de 60 cents pendant les périodes de pointe. Ce qui était autrefois une infrastructure publique génère maintenant des milliards de profits pour l’entreprise espagnole Ferrovial et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada – prélevés directement des poches des navetteurs.
Les soins de santé représentent peut-être la frontière de privatisation la plus préoccupante. Plusieurs provinces, notamment l’Ontario et l’Alberta, ont augmenté les contrats avec des établissements chirurgicaux privés pour réduire les arriérés causés par la pandémie. Bien que cela crée l’apparence de temps d’attente réduits, Médecins canadiens pour le régime public met en garde contre un effet secondaire troublant : les professionnels de la santé quittent le système public déjà sous pression.
« Quand vous introduisez un système privé parallèle, vous êtes essentiellement en compétition pour le même bassin limité de travailleurs de la santé, » explique Dr. Melanie Bechard, présidente de Médecins canadiens pour le régime public. « Nous voyons cela se dérouler en temps réel – des infirmières quittant leurs postes hospitaliers pour des cliniques privées offrant de meilleures conditions de travail, ce qui déstabilise davantage les soins publics. »
L’économie ne s’équilibre rarement non plus. Une analyse de 2022 par le Centre canadien de politiques alternatives a révélé que les procédures chirurgicales dispensées par le privé mais financées par le public en Colombie-Britannique coûtaient en moyenne 12% de plus que les mêmes procédures effectuées dans les hôpitaux publics. Cette prime allait vers les marges bénéficiaires, la rémunération des dirigeants et le marketing – des dépenses qui n’existent pas dans les modèles de prestation publics.
Pourtant, la privatisation continue d’avancer, en partie parce que ses coûts réels restent diffus et difficiles à quantifier. Lorsque BC Hydro a conclu des contrats à long terme avec des producteurs d’électricité privés, les contribuables se sont retrouvés enfermés dans des prix supérieurs au marché pendant des décennies. Le vérificateur général provincial a estimé que ces arrangements coûteraient aux Britanno-Colombiens 16 milliards de dollars supplémentaires sur la durée des contrats.
« Il y a cette étrange contradiction où les gouvernements affirment qu’ils ne peuvent pas se permettre des services publics, puis concluent des accords qui coûtent plus cher aux contribuables à long terme, » note Keith Reynolds, ancien analyste financier du secteur public. « L’avantage financier va souvent aux investisseurs privés tandis que les risques demeurent avec le public. »
Le plus préoccupant est peut-être lorsque la privatisation affecte les populations vulnérables. Dans le secteur des soins de longue durée en Ontario, une étude de l’Université McMaster a montré que les établissements à but lucratif ont connu des éclosions de COVID-19 plus importantes et plus mortelles que leurs homologues publics. Le motif du profit avait créé des incitations structurelles à minimiser les coûts de personnel et à maximiser le nombre de lits – des facteurs qui se sont avérés catastrophiques pendant une pandémie respiratoire.
Certaines communautés résistent. À Halifax, les résidents ont fait campagne avec succès contre un projet de PPP (partenariat public-privé) pour le traitement des eaux usées après avoir analysé les échecs des PPP dans les municipalités voisines. Les communautés autochtones à travers le Canada se sont également prononcées contre la privatisation des systèmes d’eau, soulignant à la fois les préoccupations de souveraineté et les performances inégales des opérateurs privés dans les endroits éloignés.
« La privatisation n’est pas une inévitabilité économique – c’est un choix politique, » soutient Rosemary Warskett, chercheuse en travail et ancienne représentante nationale de l’Alliance de la Fonction publique du Canada. « Et de plus en plus, les communautés choisissent différemment lorsqu’elles comprennent les implications à long terme. »
Des approches alternatives existent. À Edmonton, la ville a réintégré les services de gestion des déchets précédemment sous-traités après avoir constaté qu’elle pouvait fournir le même service à moindre coût tout en offrant de meilleures conditions de travail. Le système public de garderie du Québec a démontré que des services publics bien conçus peuvent offrir de meilleurs résultats à des coûts inférieurs que les alternatives basées sur le marché.
Le débat se concentre ultimement sur ce que les Canadiens valorisent. Les services publics sont-ils simplement des marchandises à être livrées par le soumissionnaire le moins disant, ou sont-ils des expressions de valeurs partagées et de provision collective? La réponse façonne non seulement la prestation de services, mais aussi la nature même de la citoyenneté.
« Quand nous privatisons les services publics, nous ne changeons pas seulement qui les fournit – nous changeons notre relation avec eux, » dit Dr. Whiteside. « Les citoyens deviennent des clients, les besoins publics deviennent des demandes du marché, et notre responsabilité collective devient un choix de consommateur individuel. »
En montant finalement dans cet autobus retardé à Toronto, je me suis demandé si nous posions la mauvaise question. Au lieu de débattre si la privatisation peut sauver des services publics sous-financés, peut-être devrions-nous nous demander pourquoi nous avons permis à ces services essentiels d’être systématiquement affamés en premier lieu. La véritable efficacité pourrait résider non pas dans la prestation privée, mais dans le financement adéquat des systèmes publics que les Canadiens ont bâtis au fil des générations.