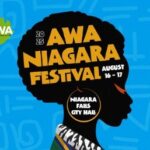La lumière se disperse différemment à travers la neige dans cette partie des Territoires du Nord-Ouest. J’ai visité plusieurs communautés nordiques au fil des ans, mais la qualité cristalline du soleil hivernal arctique me surprend encore à chaque fois. Debout aux côtés de Mabel Firth, une aînée gwich’in de 73 ans qui suit les modèles de migration des caribous depuis son enfance, je me sens humble devant l’immensité de la toundra qui s’étend devant nous.
« Les caribous nous ont toujours montré le chemin, » me confie Mabel, son souffle formant des nuages dans l’air à -30°C. « Mais les sentiers qu’ils suivent maintenant ne sont plus les mêmes que ceux que ma grand-mère m’a enseignés. Le territoire change plus vite que nos histoires ne peuvent suivre. »
C’est ce paysage arctique en transformation rapide qui a réuni une coalition improbable de gardiens du savoir autochtone, de climatologues et d’experts en intelligence artificielle dans ce qui pourrait être l’un des partenariats de conservation les plus prometteurs du Nord canadien.
Le troupeau de caribous de la Porcupine, dont la migration annuelle s’étend sur plus de 2 400 kilomètres à travers l’Alaska, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, fait face à des défis sans précédent. Les changements climatiques ont modifié les patterns de végétation, introduit de nouveaux prédateurs et créé des conditions de glace instables qui perturbent les routes traditionnelles. Parallèlement, le développement industriel menace les aires de mise bas cruciales.
« Nous assistons à des changements climatiques à un rythme presque trois fois supérieur à la moyenne mondiale ici dans l’Arctique, » explique Dr. Sonia Zhang, climatologue à Environnement et Changement climatique Canada, qui surveille les variations de température dans la région depuis une décennie. « Ce qui était autrefois des changements saisonniers prévisibles est devenu erratique et extrême. »
Cette imprévisibilité constitue une menace existentielle pour les caribous et, par extension, pour les quatorze communautés autochtones dont l’identité culturelle et la sécurité alimentaire sont liées à ces animaux depuis des milliers d’années.
C’est là qu’intervient le Projet Migration Nord, une initiative de conservation innovante qui associe les connaissances écologiques traditionnelles à des algorithmes avancés d’apprentissage automatique pour protéger les corridors de déplacement des caribous en temps réel.
« Nous ne remplaçons pas les connaissances traditionnelles, nous les amplifions, » explique Darren Nasogaluak, un ingénieur logiciel inuvialuit qui a contribué à la conception du système d’IA. « Les aînés nous disent quoi chercher, et la technologie nous aide à l’observer sur une zone beaucoup plus vaste que ce que les observateurs humains pourraient surveiller seuls. »
Le système fonctionne en intégrant plusieurs flux de données: imagerie satellitaire suivant la profondeur de la neige et les changements de végétation, mesures des stations météorologiques, images des caméras de surveillance de la faune et, peut-être plus crucial encore, observations des utilisateurs autochtones du territoire qui signalent les conditions via une application spécialisée disponible en quatre langues, dont le gwich’in et l’inuvialuktun.
Les algorithmes d’apprentissage automatique traitent ces informations pour identifier les obstacles émergents aux déplacements des caribous et prédire les voies alternatives que les troupeaux pourraient suivre. Ces informations permettent aux communautés et aux autorités de conservation de prendre des décisions éclairées concernant l’utilisation des terres, les pratiques de chasse et les interventions d’urgence lorsque nécessaire.
« L’hiver dernier, le système a identifié une dangereuse accumulation de glace le long d’un passage de rivière clé deux semaines avant l’arrivée prévue des caribous, » se souvient Michael Francis, technicien de la faune au gouvernement Vuntut Gwitchin. « Nous avons pu établir des points de traversée alternatifs avec des sentiers de neige damée. Sans cet avertissement précoce, nous aurions pu perdre des dizaines d’animaux par noyade ou blessure. »
La technologie s’est également avérée précieuse pour atténuer les perturbations d’origine humaine. Lorsque l’exploration minière a menacé de croiser un corridor de migration nouvellement établi l’année dernière, les données du système d’IA ont fourni des preuves qui ont contribué à obtenir un ordre de protection d’urgence en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
Si les aspects technologiques sont impressionnants, la véritable innovation réside dans la manière dont le projet a été structuré pour centrer la gouvernance autochtone. Contrairement aux efforts de conservation passés qui traitaient souvent les communautés nordiques comme des sujets plutôt que comme des leaders, le Projet Migration Nord fonctionne selon un cadre de souveraineté des données autochtones.
« Chaque octet d’information appartient aux personnes dont le territoire provient, » explique Dr. Lisa Qiluqqi Koperqualuk, présidente du Conseil circumpolaire inuit Canada et architecte clé du modèle de gouvernance du projet. « La technologie sert les communautés, pas l’inverse. »
Cet engagement s’étend au fonctionnement même de l’IA. Les modèles d’apprentissage automatique ont été soigneusement conçus pour incorporer l’Inuit Qaujimajatuqangit (savoir traditionnel inuit) et les connaissances gwich’in du comportement des caribous comme fondamentales plutôt que comme des contributions supplémentaires.
« La science occidentale a tendance à séparer les choses en catégories—habitat, climat, animaux, personnes, » observe Jacob Snowshoe, gardien du savoir tetlit gwich’in qui siège au comité directeur du projet. « Notre savoir ne fonctionne pas ainsi. Nous voyons les connexions entre toutes choses. L’IA a dû apprendre à penser de façon plus holistique pour être vraiment utile ici. »
Tout le monde n’a pas adopté l’intervention technologique. Certains aînés ont exprimé un scepticisme initial quant à l’introduction d’algorithmes complexes dans les pratiques traditionnelles de gestion de la faune.
« J’étais contre au début, » admet Peter Ross, un chasseur de Fort McPherson. « Je me disais: ‘Nous nous sommes débrouillés sans ordinateurs pendant des générations, pourquoi commencer maintenant?’ Mais quand j’ai vu comment cela aidait les plus jeunes à se connecter au territoire et à prendre de bonnes décisions sur quand et où chasser, j’ai changé d’avis. »
Les premiers résultats sont prometteurs. Depuis la mise en œuvre du système il y a trois ans, les taux de survie des faons ont augmenté de 8% selon les données d’Environnement et Changement climatique Canada. Les communautés rapportent un plus grand succès de chasse avec moins d’efforts, un facteur important alors que les prix du carburant dans les communautés nordiques continuent d’augmenter.
Mais le projet fait face à des défis importants. La connectivité Internet fiable reste inégale dans une grande partie de la région, limitant la collecte de données en temps réel. La technologie sophistiquée nécessite une maintenance et des mises à jour continues, soulevant des questions sur la durabilité à long terme une fois que le financement initial du Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat du gouvernement fédéral expirera l’année prochaine.
La question éthique qui hante de nombreuses technologies de conservation est peut-être la plus préoccupante: à quel moment l’intervention devient-elle une interférence avec les processus naturels?
« Nous marchons sur une ligne fine, » reconnaît Dr. Zhang. « Nous voulons aider les caribous à s’adapter aux changements causés par l’homme sans les rendre dépendants de la gestion humaine. L’objectif est de leur donner l’espace pour trouver leur propre voie. »
Alors que l’Arctique continue de se réchauffer et de se transformer, les leçons de cette approche innovante de conservation de la faune pourraient s’avérer précieuses bien au-delà de la gestion des caribous. Des systèmes similaires sont déjà envisagés pour surveiller les sites de tanières d’ours polaires et la migration des bélugas dans la baie d’Hudson.
De retour sur la toundra avec Mabel, je la regarde ouvrir l’application du projet sur son téléphone—une juxtaposition frappante de connaissances anciennes et de technologie de pointe dans ses mains usées par le temps. Elle pointe une carte numérique montrant le mouvement prévu du troupeau dans les semaines à venir, puis fait un geste vers l’horizon lointain.
« Les machines apprennent à lire le territoire, » dit-elle avec un léger sourire. « Mais nous devons encore leur apprendre à l’écouter. »
Dans cet Arctique en rapide évolution, cela pourrait être la leçon la plus importante de toutes.