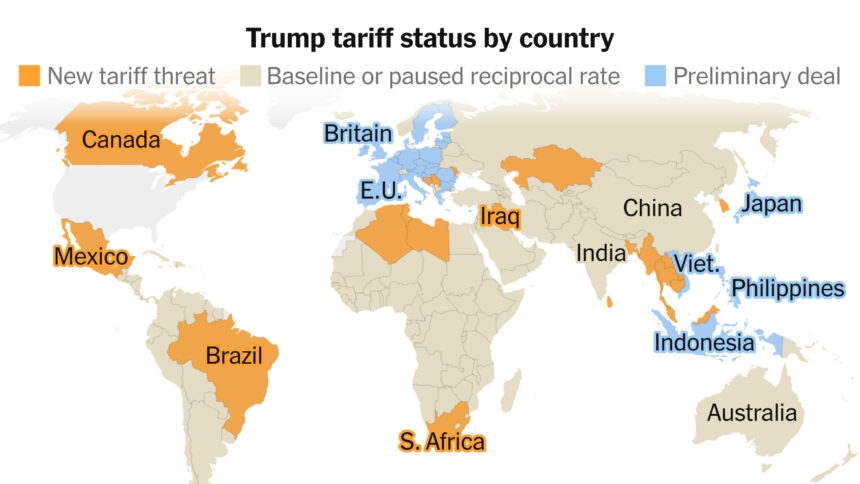Sous la chaleur estivale de Washington D.C., les experts en politique et en commerce transpirent pour plus que juste l’humidité. La dernière série de tarifs douaniers du président Trump visant les importations canadiennes a provoqué des ondes de choc à travers les chaînes d’approvisionnement nord-américaines intégrées depuis des générations.
« Nous assistons à la perturbation la plus significative des relations commerciales entre les États-Unis et le Canada depuis les années 1930, » explique Marianne Cowell, analyste principale en commerce au Peterson Institute for International Economics. « Ce ne sont pas simplement des chiffres sur une feuille de calcul—ce sont des relations et des moyens de subsistance qui sont fondamentalement altérés. »
Les nouveaux tarifs—allant de 25% sur le bois d’œuvre canadien à un stupéfiant 45% sur les produits laitiers—représentent une escalade dramatique dans la politique commerciale « America First » de l’administration. Selon les données du bureau du Représentant américain au commerce, le Canada a exporté pour 319 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis l’année dernière, faisant de ce pays le plus important partenaire commercial de l’Amérique et la destination de près de 75% de toutes les exportations canadiennes.
En visitant le Port de Detroit la semaine dernière, j’ai constaté les effets immédiats de première main. Les camions faisaient la queue sur des kilomètres aux postes frontaliers, les nouvelles procédures d’inspection ajoutant des heures aux temps de transit. Mike Desjardins, un chauffeur québécois qui traverse la frontière depuis 22 ans, offre une évaluation sombre : « Avant, je faisais deux allers-retours par semaine. Maintenant, je m’estime chanceux si j’en complète un seul. »
Les conséquences économiques se manifestent déjà. Une analyse conjointe de la Banque du Canada et de la Banque Royale du Canada suggère que ces tarifs pourraient réduire le PIB canadien de 1,8% au cours de la prochaine année, tandis que les prix à la consommation américains pour les biens touchés pourraient augmenter entre 4,5% et 9,7%. Les matériaux de construction ont été particulièrement touchés, avec les prix du bois d’œuvre qui ont bondi de 17% en seulement trois semaines.
Derrière ces statistiques se trouvent de véritables communautés prises dans le feu croisé. À Sault Ste. Marie, une ville à cheval sur la frontière entre l’Ontario et le Michigan, l’industrie sidérurgique intégrée qui a soutenu les deux côtés pendant plus d’un siècle fait maintenant face à une incertitude sans précédent.
« Mon grand-père a travaillé chez Algoma Steel, mon père y a travaillé, et maintenant moi aussi, » dit Raymond White, un sidérurgiste de troisième génération. « Pour la première fois, je dis à mes enfants de chercher des carrières différentes. L’instabilité est trop grande. »
La Maison Blanche a justifié ces mesures en citant des préoccupations de sécurité nationale en vertu de la Section 232 de la Loi sur l’expansion du commerce, le même raisonnement utilisé pour les tarifs précédents sur l’acier et l’aluminium. Lorsqu’on lui a demandé des précisions, le secrétaire au Commerce Wilbur Ross a pointé du doigt un déficit commercial dans certains secteurs, malgré le fait que la relation commerciale globale entre les États-Unis et le Canada soit presque équilibrée selon les propres données du département du Commerce.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau a répondu avec des contre-mesures ciblées, imposant des droits sur 14 milliards de dollars de marchandises américaines. « Nous ne nous laisserons pas bousculer, » a déclaré Trudeau lors d’une réunion d’urgence du cabinet à Ottawa. Le gouvernement canadien a également déposé des contestations par le biais des mécanismes de règlement des différends de l’ALENA et de l’Organisation mondiale du commerce.
Ce qui rend ces tarifs particulièrement perturbateurs est leur impact sur les chaînes d’approvisionnement complexes. La fabrication moderne implique souvent que des composants traversent les frontières plusieurs fois avant qu’un produit final ne soit complété. L’industrie automobile, centrée autour de la région des Grands Lacs, illustre parfaitement cette intégration.
« Un véhicule typique fabriqué en Amérique du Nord traverse les frontières jusqu’à sept fois pendant la production, » explique Carlos Gutierrez, ancien secrétaire américain au Commerce et maintenant consultant pour des sociétés multinationales. « Quand vous ajoutez des tarifs à chaque traversée, l’effet cumulatif devient intenable. »
Des économistes de tout le spectre politique ont exprimé leur inquiétude. Une enquête auprès de 42 économistes de premier plan par l’Université de Chicago a révélé que 95% croient que ces tarifs nuiront aux consommateurs américains, avec seulement un exprimant de l’incertitude et aucun soutenant la politique.
Dans les communautés frontalières, la dimension humaine transcende l’économie. Windsor, Ontario et Detroit, Michigan fonctionnent presque comme une seule zone économique, avec des milliers de personnes traversant quotidiennement pour le travail, les visites familiales et le commerce. De nouvelles barrières menacent cette relation organique.
Le maire de Windsor, Drew Dilkens, a décrit la situation comme « déchirant le tissu de notre communauté. » Sa ville a établi un fonds d’urgence pour aider les travailleurs touchés par les ralentissements dans les usines automobiles, qui ont déjà annoncé des mises à pied temporaires alors qu’elles s’adaptent à la nouvelle réalité commerciale.
Les entreprises américaines dépendantes des intrants canadiens se démènent pour s’adapter. Malcolm Rodriguez, PDG de Northern Building Products basé au Minnesota, m’a confié que son entreprise fait face à une triple menace : « Des coûts matériels plus élevés, des livraisons retardées et l’incertitude concernant les prix futurs rendent impossible de soumissionner sur des projets avec confiance. »
L’entreprise de Rodriguez a suspendu les plans d’expansion d’une installation qui aurait ajouté 47 emplois, rejoignant une liste croissante d’investissements mis en attente en raison de l’incertitude commerciale.
Les retombées diplomatiques ont été tout aussi graves. La ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland a annulé une visite prévue à Washington, tandis que plusieurs forums de coopération état-province ont été reportés indéfiniment. Une source diplomatique canadienne de haut rang, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a qualifié la relation comme étant « à son point le plus bas de l’histoire moderne. »
Les partisans des tarifs, y compris le Représentant au commerce Robert Lighthizer, soutiennent que la douleur à court terme produira des gains à long terme grâce à des conditions commerciales renégociées. Cependant, des économistes comme le lauréat du prix Nobel Paul Krugman répliquent que perturber des relations commerciales établies produit typiquement plus de dommages durables que de bénéfices.
« Les guerres commerciales sont fondamentalement des jeux à somme négative, » a écrit Krugman dans une analyse récente. « La destruction de l’efficacité est réelle et permanente, tandis que tout levier de négociation est temporaire et souvent illusoire. »
À l’approche de l’automne, les deux pays font face à des décisions cruciales. Les mesures de représailles du Canada prennent pleinement effet le mois prochain, tandis que l’administration américaine doit décider d’exempter ou non certaines industries confrontées à des perturbations graves. Entre-temps, les citoyens ordinaires des deux côtés de la plus longue frontière non défendue du monde se retrouvent participants involontaires à une expérience économique à enjeux élevés sans issue claire.